MITATE PLUS
HISTOIRE DU KIMONO, Edo (1)
Le Japon du 17e siècle connut enfin la paix.
Edo (l'actuelle Tôkyô) n'était encore qu'un hameau perdu qui vivait surtout de la pêche dans la plaine de Musashi. Lorsque Tokugawa Ieyasu, fondateur d’une dynastie de shôgun, ou chefs militaires, y installa son gouvernement en 1590, la ville se développa considérablement attirant peu à peu commerçants et financiers de toutes les provinces. Cette première moitié du 17e siècle fut une période de transition fortement marquée par l'influence de la culture de Momoyama.
Le Japon ferma alors ses frontières aussi bien aux étrangers qu’à ses propres ressortissants. Les premiers ne pouvaient pas se rendre dans les îles nippones, et les seconds ne pouvaient pas en sortir. Cet isolement (sakoku) débute en 1639, lorsque les missionnaires chrétiens sont expulsés du pays sur ordre de Tokugawa Ieyasu.
Au cours de cette période d'isolation, avec la culture paysanne et artisanale, la ville fut l'autre grand creuset d'une authentique culture originale, urbaine et populaire, avec un esprit pragmatique et frondeur, un art de vivre et une esthétique encore perceptible de nos jours, considérablement affranchie des codes alambiqués de l'aristocratie et débarrassée d'un certain pessimisme véhiculé par le bouddhisme.
C’est dans ce pays mystérieux, quasiment secret, à l’écart du monde occidental et de ses tentacules politiques et commerciaux où des commerçants hollandais eurent l’autorisation de s’installer dans une petite enclave près de Nagasaki, l’île de Dejima.

LA COUR IMPÉRIALE
Kyôto demeurait toujours le centre de l'activité culturelle représentée par les héritiers de la culture traditionnelle (nobles de la cour, daimyô, moines, chefs de maisons de commerce renommée…) qui s'entouraient de meubles et d'ustensiles rares, de provenance étrangère et de grand luxe, organisaient des réunions de thé, admiraient les spectacles de théâtre nô, pratiquaient la poésie, étudiaient les classiques chinois et japonais etc…, le tout dans une ambiance raffinée et aristocratique.

Depuis la fin de l'époque de Heian, le costume formel des femmes de la cour restait, pour faire simple, le jûni-hitoe, cette parure colorée composée de plusieurs robes superposées. Suite aux guerres de Ônin (1467-77) dont les affrontements eurent surtout lieu dans les rues de Kyôto, de nombreux trésors culturels furent détruits. La capitale ne fut plus alors qu'un champ de ruines calcinées où les anciens us et coutumes se délitèrent peu à peu. Cette guerre marque une coupure chronologique importante dans l'histoire du Japon. Des changements notoires apparaissent dans de nombreux domaines dont celui des costumes (renouveau de la jupe à traîne mo, types de robes et ordre de succession, coiffures…).

Cette tenue officielle sokutai qui date du milieu de l'époque de Heian était portée au palais impérial par les fonctionnaires civiles de la noblesse, de la période de Muromachi jusqu'aux années Edo avec quelques légères modifications notamment au niveau de la coiffe.
L'ÉLITE GUERRIÈRE
Au cours des cinquante premières années du 17e siècle, le bakufu balaya toute opposition, répartit habilement les daimyô, tint les nobles de la cour à l'écart du pouvoir politique et força la noblesse guerrière de tout le pays à résider en alternance (6 mois ou un an sur deux) dans leur domaine et à Edo (1635: système du sankin kôtai), sous prétexte de certaines tâches militaires mais en réalité, un excellent moyen de garder les daimyô sous contrôle. Ils étaient contraints de laisser épouse et enfants en otage à Edo quand ils regagnaient leur fief. Les frais relatifs à ces déplacements et aux séjours coûteux à la capitale réduisaient considérablement leurs budgets, eux qui étaient censés mener grand train. Une fois de retour dans leur fief, ils ne disposaient plus des moyens nécessaires pour fomenter quelque complot contre le gouvernement.
De plus, la fortune des daimyô dépendait de la production de leurs terres et le code social leur interdisait de s'adonner à des activités marchandes ou financières. Or, au cours de cette période, s'ajoutèrent des mesures économiques agraires qui les défavorisèrent` et menacèrent leur situation financière. Soucieux malgré tout de conserver les apparences face aux autres seigneurs, leur demande en services et objets de luxe finit par créer un marché énorme qu'un nombre grandissant d'artistes, d'artisans et de commerçants, qui constituaient la majeure partie de la population citadine, tentaient de satisfaire ainsi qu'une une foule de petites gens en quête d'un avenir meilleur.
Edo s'agrandit alors à une vitesse spectaculaire.

Sankin kôtai, les vassaux sont obligés de se rendre à Edo pour y déclarer leur fidélité (1635) au shôgun. Ces imposants déplacements en cortèges seigneuriaux en imposait à la population et permirent aussi le développement des "Cinq grandes routes" du pays.

Chaque tenue formelle pour les daimyô et les guerriers correspondait à un rang (les rangs les plus élevés étant les 3 premiers):
• au-dessus du 3e rang, le hitatare
• kariginu pour le 4e rang
• daimon pour le 5e rang
• suô pour le 6e rang et en-dessous
• le hôi était autorisé pour les nombreux guerriers non pourvus de rang.
Exception faite pour les très grands fiefs, la plupart des daimyô se situaient au 5e rang.
Ce daimon différait de la tenue portée au Moyen Age dans la qualité du tissu et dans la forme du hakama qui se portait très long. Ce daimyô du 5e rang porte un daimon-nagabakama (long hakama) qui était devenu un habit formel porté au palais.
Le kosode d'hiver porté en-dessous était un noshime kosode, que l'on associait aussi avec d'autres tenues officielles. Il comportait des motifs arrangés sur le bas des manches et au niveau de la taille. Les guerriers ordinaires dépourvus de rang étaient autorisés à porter un daimon à condition qu'il fut en lin.

Sokutai d'été pour un bushi de 5e rang de la noblesse guerrière, porté à l'occasion d'événements exceptionnels. La robe du dessus ketteki no hô est fermée par une ceinture hirao.

Le naga-hitatare (veste et hakama aux jambes très longues) était l'habit formel des daimyô de statut supérieur au 4e rang lors de leur visite au palais à l'occasion de cérémonies particulières. Les hitatare violets et rouges étaient exclusivement réservés au shôgun et au chambellan. Le kosode du dessous devait être blanc. Les codes de couleurs des cordons de la coiffe (eboshi) et du hitatare (devant et manches) correspondaient aussi au rang de chacun.

Depuis les réformes menées par Toyotomi Hideyoshi à la fin du 16e siècle, on n'entre plus dans le groupe des samourai que par la naissance. Le statut s'apparente dorénavant à celui d'une noblesse militaire facilement contrôlable. De spécialistes de la guerre, ils se transforment en administrateurs vivant dans les villes aux pieds des châteaux des daimyô.
Durant toute la période d'Edo, ils constituent une couche moyenne supérieure qui encadre la société et la tire vers le haut. Mais tous les samurai ne s'adaptent pas aussi facilement: certains se retrouvent licenciés et déclassés suite à la chute de familles seigneuriales. Ils errent dans un pays qui n'a plus besoin d'eux, ce sont les rônin. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas faits pour une vie tranquille et un emploi régulier, causant des troubles dans la ville et vivant à la limite du crime. Toutefois, on trouvait parmi eux quelques érudits comme Matsuo Bashô.
Guerrier en tenue hitatare (avec hakama long) sur un kosode blanc, avec sabre et éventail. Les extrémités de la ceinture blanche retombent à l'avant.

Dès le début du 17e siècle, le naga-kami-shimo (kami-shimo long), autrefois appelé kataginu, en soie était la tenue formelle des daimyô et bushi de haut rang, lorsqu'ils étaient au château en présence du shôgun et en dehors des événements officiels. Il comporte une sorte de gilet à larges épaules et un hakama. Pour les rangs inférieurs, il était en lin uni (asa-kamishimo) gris le plus souvent ou orné de très petits motifs teints (komon) et rehaussé de 4 kamon tout comme le kosode noshime en soie porté en dessous.

Ce fonctionnaire de 4e rang porte un kariginu en gaze de soie et un pantalon sashinuki, bouffant et serré aux chevilles.

Parmi les costumes de guerriers, le suô, comme le daimon étaient des variantes du hitatare. Tenue officielle réservée aux guerriers et nobles inférieurs au 6e rang ou dépourvus de rang. Le naga-suô était lui, réservé aux guerriers du 6e rang. À la différence du daimon, le hakama du suô était désormais pourvu d'une planchette dans le dos ornée d'un kamon et la ceinture, réalisée dans le même tissu que l'ensemble, est plus étroite. À partir de la période de Muromachi, on appose 5 kamon sur la veste et 2 sur le hakama. À cette époque, on continue d'appeler suô, le hitatare de chanvre sans kamon. La coiffe eboshi vue de face semble être triangulaire. Si le hakama était court, le suô se nommait alors ko-suô (petit suô).
À gauche, le naga-suô est porté sur un noshime kosode dont on voit les motifs quadrillés au niveau de la taille. Haut et bas sont de la même couleur et de la même étoffe. Les cordons (munahimo) de la veste peuvent être en peau de daim ou en soie blanche tressée.

Les guerriers dépourvus de rang sont autorisés à porter un hôi. Le hakama bouffant est gris bleu en tissu uni. La tunique à col rond est ouverte au niveau des épaules et se ferme par un ceinture dont les extrémités se voient à l'avant. Sous la robe, on aperçoit un noshime kosode orangé.
ARRIVÉE DES PREMIERS EUROPÉENS

Les visiteurs européens étaient qualifiés avec mépris de namban (Barbares du sud). La rencontre entre ces deux cultures fut frontale. De grands paravents représentant les Européens et leur bateaux sont la preuve de la sensation produite par leur arrivée.
Des nouveautés vestimentaires commencèrent à apparaître avec notamment le karusan, sorte de pantalon court, d'origine portugaise (calçao, qui donnera caleçon), importé par les namban-jin à la fin du 16e et au début du 17e siècle. Il fut d'abord adopté par les shôgun et les samurai puis quelques décennies plus tard, ce sont les classes populaires et les artisans en tous genres qui en firent un vêtement de travail.

LA CLASSE PAYSANNE

La hiérarchie sociale était clairement établie. Au sommet de la pyramide, le shôgun, la famille impériale, la noblesse de cour et les daimyô locaux suivis par les guerriers armés (samurai) et les employés occupant des postes administratifs. La classe moyenne était constituées par les cultivateurs de riz qui formaient 80% de la population. La classe inférieure regroupait les artisans et les marchands (chônin) qui représentaient la majorité de la population citadine d'Edo et des autres villes importantes.
Photo: série télévisée populaire "超高速!参勤交代". L'action se situe vers 1735.

Dans les campagnes, les propriétaires terriens (shôya) étaient autorisés à porter des vêtements de soie (tsumugi etc…) mais les teintures rouges et violette leur restaient interdites. Les paysans de plus basse condition continuaient à porter des vêtements tissés à base de fibres végétales locales et de coton (depuis le 16e siècle).
Comme le dictait la loi, les hommes devaient s'astreindre aux travaux des champs, les femmes à leur métier à tisser. Pour se protéger du froid, les plus pauvres portaient des coiffes en papier (kami-zukin).

DÉBUTS DU KOSODE FÉMININ (1595-1644)
LA CLASSE GUERRIÈRE

"Cerisiers en fleurs au temple Kiyomizu-dera", 清水寺観桜図屏風, 17e siècle.
Pendant la période de Nara ou de Heian, le kosode n'était qu'un simple sous-vêtement porté par les nobles ou un vêtement de travail porté par le peuple. Son évolution se poursuivit avec les années pour enfin acquérir un nouveau statut, celui de vêtement à part entière, porté à l'extérieur et visible de tous. Depuis la fin du 16e siècle, les kosode constituaient l'élément principal de la garde-robe des femmes de la classe guerrière et des femmes du peuple et devinrent alors un indicateur absolu de la position sociale de chacun. Le obi se transforma et la simple cordelette devint une ceinture un peu plus large.
Les conséquences sociales des conflits militaires constants des années Sengoku (milieu 15e~fin 16e) ajoutées au luxe et à la grandeur caractéristiques de l'époque de Momoyama ont montré un mélange des genres peu commun où les excès se côtoyaient. Les représentations picturales de cette époque, principalement sur paravents, nous montrent des kosode richement brodés et teints, portés larges mais avec des manches assez courtes laissant voir l'avant-bras.
KEICHÔ KOSODE


Les kosode de l'époque Keichô (1596-1615) appelés Keichô kosode ou nuihaku kosode furent très à la mode parmi les femmes de la classe guerrière. Confectionnés surtout dans des satins (rinzu), ils étaient ornés, sur toute la surface, de motifs réalisés à l'aide de techniques variées (surihaku, shibori, broderies) à tel point que le fond du tissu d'origine n'était même plus visible. On les appelait aussi jinashi-kosode (sans tissu). Les couleurs dominantes étaient le noir et le rouge, ce qui leur donnait un aspect sombre et la longueur des manches augmenta légèrement.
Le style Keichô se distinguait surtout des styles précédents par ses décors et par la structure des motifs qui mêlaient dans un joyeux désordre courbes, lignes droites, formes géométriques variées, motifs animaliers et floraux, objets du quotidien brodés...Les thèmes empruntés à la nature dominaient mais les proportions parfois inversées, contribuaient ainsi au sentiment d'abstraction, qui avec l'irrégularité des zones teintes, créait une ambigüité dans le rapport entre les motifs et l'arrière-plan.
La feuille métallique formait des motifs individuels variés au lieu de simplement remplir les vides entre les motifs brodés. La teinture shibori était, elle aussi, utilisée plus fréquemment qu'avant pour créer de larges zones de couleur différente qui étaient la composante principale de ce style.
La complexité et le coût inhérents à ce style le limitait à la classe des guerriers de haut rang ou à la classe marchande très cultivée (chônin), capable d'interpréter les évocations et allusions littéraires chinoise et japonaise médiévales parfois présentes sur ces kosode. Ce style persista jusque dans les années de l'ère Kanbun (1661-1673), avec quelques modifications. La technique nuihaku retrouvera un nouveau souffle lorsqu'elle sera adoptée pour la réalisation des luxueux costumes de théâtre nô.
Par la suite, les courtisanes de luxe (tayû) les arborèrent dans les quartiers de plaisirs de Kyôto vers le milieu du 17e siècle.

Ce kosode de la période intermédiaire de Momoyama et du début d'Edo est le plus bel exemplaire de keichô kosode qui nous soit parvenu. Il aurait appartenu à Yodogimi, l'épouse de Hideyoshi Toyotomi.

Keichô kosode en satin orné d'un clair de lune avec nuages en rosaces accompagnés de vols d'oiseaux et fleurs de saison disposés en arc (broderies et shibori).


洛中洛外図, La ville (Kyôto) et ses environs, Iwasa Matabei, vers 1615.
Pour sortir sans être reconnue, les femmes de la noblesse et de l'élite guerrière comme les épouses de daimyô, puis de riches marchands pouvaient se recourir la tête d'un second kosode (kazuki). Peu à peu, cette habitude se répandit jusque dans les classes populaires. Il se portait également lors des cérémonies de mariage.
En 1652, suite à une tentative d'assassinat au temple Zôjô-ji dans le quartier de Shiba à Edo où des rônin complotistes utilisèrent des kazuki pour se dissimuler dans la foule, le port du kazuki fut interdit à Edo.

Des scènes de ce genre sont caractéristiques de la période Kan-ei (1624-1644). Une courtisane âgée porte un jinashi kosode et les kosode ornés de larges motifs et fermés par des obi encore étroits étaient à la mode. Les grandes villes avaient leurs lieux de transgression où les codes sociaux n'avaient plus cours: les théâtres avec le kabuki, les lieux de fêtes avec leurs attractions et leurs forains et les quartiers de plaisirs où se développa la culture urbaine qui connut son apogée au début du 19e siècle.
Divertissements dans une résidence à Edo (paravent, 17e siècle), 邸内遊楽図屏風
ESSOR DE LA CLASSE BOURGEOISE
Au cours de cette première moitié du 17e siècle, l'économie de tout le pays se développa rapidement et se consacra entièrement à l'amélioration du commerce et de l'industrie. Le commerce intérieur et extérieur prospéra et cette activité nouvelle entraîna un déplacement de la population des campagnes vers les villes. Les daimyô contraints au sankin kôtai construisirent des maisons à Edo, dépensaient de grandes sommes et donnaient du travail aux ouvriers, commerçants et artisans.
Peu à peu, la classe guerrière avec ses valeurs et ses nombreux samurai en rupture de ban, appauvris ou contraints à des tâches bureaucratiques eut tendance à se fossiliser et ce sont les autres classes sociales qui furent à l'origine d'une nouvelle culture urbaine.
En règle générale, le chônin (citadin) c'est à dire celui qui habite un quartier de la ville et non pas à l'ombre du château, était un artisan, un enseignant ou un commerçant respectable. On a beaucoup décrit les lieux de divertissement, les théâtres, les quartiers de plaisir de la société bourgeoise des 17e et 18e siècles et on a tendance à les considérer comme le cadre de la vie quotidienne d'Edo. Toutefois, sous l'influence de la classe guerrière qui méprisait le commerce et qui était guidée par l'éthique confucéenne basée sur l'importance de la loi morale du devoir et de la piété filiale, les citadins les plus sérieux les imitèrent et se joignirent à ce courant.
Dans le développement de l'industrie et de la culture nationale, un art populaire du quotidien mêlant esthétique et fonctionnalité vit le jour avec des artistes et des artisans parfaitement intégrés dans la société. Des progrès notoires ont été faits depuis le Moyen Age dans la fabrication des métiers à tisser et la production de belles étoffes en soie au dessin souvent inégalable (nishijin-ori) et en coton dans toute une variété de coloris et de modèles.

Pour les femmes de la classe bourgeoise aisée, les occasions de porter de luxueux vêtements étaient exceptionnelles et leurs kosode s'inspiraient ouvertement des keichô kosode avec des différences non négligeables quant aux techniques utilisées: en effet, la tendance était aux kosode teints comme ici, selon la technique shibori-zome et l'utilisation du dessin tracé (tsujigahana) qui déterminaient des motifs aux traits plus libres et plus hardis. Ces citadines, qui rêvaient de posséder et de revêtir ces kosode de rêve, s'étaient finalement tournées vers un genre nouveau, peut-être influencées par une mode originale et réservée alors à un groupe restreint, une population flottante à la lisière de l'ordre social qui regroupait courtisanes et kabukimono (petits voyous des rues). Les deux styles fusionneront un peu plus tard au cours de l'ère Kanbun.

Alors que les keichô kosode étaient en vogue parmi les femmes de la classe guerrière, les citadines aisées préféraient ce genre de kimono traités en shibori ou ornés de motifs dessinés (kaki-e), plus expressifs. À gauche, feuilles de bambou, fleurs de prunier et pin, à droite, feuilles de mauve et cours d'eau, brodés sur un fond en shibori.

風俗図屏風, Paravent de Hikone (1624-1644). Plusieurs personnages (musiciens, joueurs, courtisanes et kabukimono) sont rassemblés et se divertissent dans le quartier des plaisirs de Kyôto. Le régime répressif des Tokugawa accorda à la société une liberté étonnante dans l'expression culturelle, laissant le peuple se divertir tant que cela ne troublait pas l'ordre social. Il se contenta de cantonner ces quartiers à des territoires limités.

Détail du Paravent de Hikone.
Les kabukimono, ces rônin (samurai sans maître), "traîneurs de sabre, braillards, querelleurs et proches de la voyouterie" (Philippe Pons) se caractérisaient par un comportement extravagant, voire violent, et une tenue vestimentaire excentrique qui attirait le regard et leur permettait de s'affirmer dans une société où ils n'avaient pas de statut bien défini. Les motifs qui ornaient leurs kosode étaient réalisés par des teintures de type shibori.
C'est précisément au cours de cette époque que les premiers tissus imprimés d'origine thaï (Siam), ou indiennnes ("indiennes", sarasa) furent importés au Japon et que le port de vêtements en soie fut interdit à la classe paysanne pour qui seuls le lin et le coton furent autorisés.
Les beaux vêtements jouaient un rôle important dans la vie de toutes les classes de la société et les femmes des riches marchands ne reculaient devant rien pour se surpasser les unes des autres. Lors de pique-niques sous les cerisiers du parc de Ueno, les samurai et leurs invités s'abritaient derrière des rideaux aux armes de leur maison. D'autres réalisaient des rideaux de fortune en tendant entre des arbres des cordes sur lesquelles ils suspendaient leurs habits de fête et leur kimono de dessus, une vision aussi belle que les fleurs elles-mêmes, d'après les récits de l'époque.

Les paravents de style tagasode-byôbu ("De qui sont ces manches?") apparurent à la fin du 16e siècle et montraient des kosode drapés sur des supports ou suspendus à des cordes en soie. Les décors uniques et réalisés à l'aide de techniques combinées étaient innombrables et faisaient allusion à l'aristocratie, au monde flottant, à la littérature classique, à des paysages célèbres…
Le titre était tiré d'un poème anonyme du Kôkin wakashû, compilé au début du 10e siècle.
"Plus encore que leur couleur
ce fut leur parfum qui m'émut
De qui sont ces manches
qui ont effleuré
Le prunus de ma demeure ?"
Sous l'Antiquité, l'usage voulait que les femmes de haute condition parfument les manches de leurs vêtements. Les courtisanes des plus hauts rangs de l'époque d'Edo prenaient comme modèle de comportement et d'éducation les femmes de l'aristocratie civile, elles-mêmes héritières des pratiques antiques. Ainsi parfumaient-elles les manches de leur kosode. Ces représentations allusives dégagent un esprit et un érotisme propres aux quartiers de plaisir du 17e siècle.
Paravent 17e, anonyme
KANBUN KOSODE

La forme des kanbun kosode se finalisa et n'évolua plus guère: il était long et plus étroit mais comme le pli à la taille (hashori) n'existait pas encore, la marche était entravée et peu aisée, ce qui obligeait à tenir le kosode légèrement relevé pour marcher. Les manches se sont élargies et ont rallongé. Le obi lui aussi s'est imposé peu à peu et se portait assez bas (vers 1661-73). La mode des kanbun kosode se poursuivra jusqu'à la fin du 17e siècle pour faire place peu à peu à de nouveaux styles où les préférences des femmes de la classe bourgeoise et guerrière afficheront des différences plus marquées.
La culture de la classe marchande commença à prendre une place importante au milieu du 17e siècle (1661-84). Après les incendies de 1657 et de 1661 à Edo, la reconstruction d'une grande partie de la ville s'imposa et les quartiers marchands s'organisèrent. Cette urbanisation croissante associée à une demande importante de biens de consommation (et de kosode) vit l'établissement d'une classe marchande et artisanale qui prospéra rapidement. Les deux formes précédentes de kosode continuèrent à être portées et à s'influencer mutuellement pendant plusieurs décennies pour finalement ne faire plus qu'un et aboutir aux kosode de l'ère Kanbun (1661-1673) de style libre, à l'ornementation à la fois hardie, de composition simple et d'une grande sûreté.
Les portraits de bijin (belles femmes), d'acteurs ou danseurs souvent anonymes, aux coloris recherchés, rendaient le charme ambigu et séduisant des principaux protagonistes des divertissements d'Edo. La femme de gauche arbore une coiffure appelée gosho-mage (chignon du Palais) ou hyôgo. Les motifs du kosode du dessus sont teints.
Les kanbun kosode se parèrent d’une ornementation audacieuse et asymétrique dont les motifs étaient disposés selon deux modèles. Les uns partaient du haut de l'épaule gauche et traversaient toute la hauteur du kimono en passant par la hanche droite pour finir vers l'ourlet du côté droit en formant une courbe arrondie et en laissant de larges zones vierges au niveau de la taille notamment. Les autres partaient de l'épaule droite et se répartissaient vers l'épaule gauche et l'ourlet du côté droit.
Les thèmes variés (flore, faune, objets du quotidien, lettres…) sont exécutés à l'aide de techniques complexes et onéreuses: teinture shibori, broderies nuihaku avec moins de feuilles métalliques (or et argent) ou de peinture à l'encre. Les fils métalliques ronds et les pois teints en shibori (motif kanoko) y sont plus présents que sur les keichô-kosode.
Ces larges espaces sans décor n'étaient pas seulement dictés par un but esthétique. En effet, ce style s'est imposé suite aux deux grands incendies d'Edo (1657 et 1661) où beaucoup de citadins perdirent tous leurs biens. Un besoin pressant de vêtements nouveaux s'imposa. Choisir de concentrer les décors sur des espaces réduits nécessitant des techniques difficiles permit une production massive. Le kanbun kosode devint ainsi le reflet de la nouvelle classe bourgeoise et de ses goûts.
Ici aussi, on note la présence de nombreuses allusions littéraires médiévales, chinoises et japonaises et les kanji faisant référence à un poème ou à une légende furent repris avec succès. Une solide connaissance des classiques était nécessaire pour pouvoir interpréter tous ces ornements.
À cette époque, la largeur des obi variait entre 15 et 18 cm.
Devant la puissance grandissante et l'enrichissement de cette classe marchande, le gouvernement promulgua alors le premier des nombreux édits somptuaires en 1683 pour limiter cette demande de luxe; ainsi les broderies, les brocarts d'or, les ajouts de feuilles d'or et certaines teintures dont le procédé de ligatures teintes nouées shibori furent interdits dans la confection des vêtements. Des restrictions de plus en plus rigoureuses s'ensuivirent à intervalles rapprochés et il en résulta un grand changement dans la mode et dans les techniques d'ornementation. Ces restrictions furent parfois habilement détournées avec par exemple la technique de teinture suri-hitta qui imitait les ligatures à noeuds.

Fleurs de paulownia en arabesques disposées dans de longues feuilles qui courent sur toute la hauteur. Ici, le motif part de l'épaule gauche.

Des fleurs de chrysanthèmes flottent sur un cours d'eau.

Grandes feuilles d'érable ornées de fleurs de saison et d'un motif teint shibori.

Fleurs de chrysanthèmes en shibori et broderies.

Un motif qui a connu une grande popularité au cours de cette période: le biane, cet élément architectural décoratif, orné de caractères chinois et placé au-dessus d'une porte de temple par exemple.

Fleurs de mauve de taille audacieuse réalisées en shibori avec broderies.

Association de chrysanthèmes et feuilles de palmier dans une composition hardie qui respecte les codes du kanbun kosode.

Une cascade semble surgir des montagnes en arrière-plan pour se déverser dans un bassin au premier plan. Des chrysanthèmes apportent quelques touches de couleurs.
EDO, LA VILLE, LES GENS, LES LOOKS

江戸名所図屏風, "Lieux célèbres d'Edo", paravent, vers 1643-1656 Au centre d'Edo, à Nihonbashi, l'activité de la ville est alors à son comble mais après le grand incendie de 1657, tout sera à reconstruire.
Shitamachi (la ville basse) avait pour centre Nihonbashi (litt., le pont du Japon), coeur de la ville, lieu de négoce et des entrepôts ravitaillés par les canaux mais aussi point de départ des cinq principales routes de l'archipel. Cet Edo des marchands avec ses boutiquiers, ses temples, ses spectacles forains et ses ruelles qui cachaient une vie bien plus pauvre était aussi la place choisie par les autorités pour faire connaître ses ordres et exposer, à titre d'exemple, certains condamnés.
Nihonbashi était aussi le lieu de résidence des riches marchands, souvent venus du Kansai, à l'ouest du Japon et abrita également Yoshiwara, le plus grand quartier des plaisirs officiel jusqu'en 1657, année du grand incendie de Meireki qui ravagea Edo.
La réussite sociale des commerçants et des marchands qui devinrent bientôt les nouveaux riches de la capitale ainsi que le pouvoir des courtisanes, c'est à dire la rencontre du monde de l'argent et du monde des plaisirs, ont fortement influencé la mode vestimentaire des populations urbaines. Preuve en est sur les estampes qui nous renseignent sur les différentes tendances de la mode. Chaque occasion était bonne pour se mettre en grande tenue et le prestige social était étroitement lié au bon goût vestimentaire qui permettait aussi de se démarquer par son originalité.
À la fin du 17e siècle, beaucoup de marchands disposaient de moyens financiers plus importants que ceux de citadins ou de noble de naissance, tout en restant au bas de la hiérarchie sociale et en étant limités par de nombreuses lois somptuaires qui s'appliquaient à tous les domaines (notamment immobilières et vestimentaires. Il ne leur restait plus qu'un seul moyen pour dépenser leur richesse: le divertissement. C'est ainsi que naquit le "monde flottant", le plus connu étant le quartier de Yoshiwara (1657) qui s'employa à satisfaire les désirs des hommes d'Edo pendant 300 ans (1958) !

江戸名所図屏風, "Lieux célèbres d'Edo", paravent, vers 1643-1656 (détails)

Les coiffes (souvent de simples tenugui) comme on en distingue sur les illustrations ci-dessus et qui couvraient les joues et le bas du visage furent interdites en 1656.

Quasiment isolé de l'extérieur et des événements qui marquèrent le reste du monde pendant toute la période d'Edo, les Japonais n'eurent d'autre choix que de puiser dans leurs propres sources pour s'exprimer dans tous les domaines (peinture, musique, théâtre…). Cette époque est étroitement associée aux "images du monde flottant" (ukiyo-e) qui illustrèrent d'abord le caractère éphémère de la vie terrestre, souvent douloureuse et bien trop brève puis le monde de l'hédonisme, de la mode et d'un certain art de vivre avec la fréquentation des quartiers de plaisirs ou des théâtres de kabuki comme sur cette gravure colorée à la main où des courtisanes et leurs clients sont en train de s'amuser, de boire, de jouer de la musique dans un banquet au Yoshiwara. À cette époque, Yoshiwara fut transféré à la périphérie est de la capitale.
Hishikawa Moronobu (vers 1683).
"[…] Vivre uniquement pour l'instant présent, porter toute sons attention aux beautés de la lune, de la neige, des cerisiers en fleurs et des feuilles d'érable; chanter, boire du vin, tout simplement se laisser vivre avec plaisir, fermer les yeux sur la pauvreté environnante, bannir tout chagrin, se laisser porter comme une bouteille par le courant du fleuve: voilà ce que nous appelons le Monde Flottant […]."
Asai Ryoi, Ukiyo-monogatari (Roman du monde flottant)
L'estampe comme illustration de livres ou simple tract publicitaire distribué dans la rue fut un extraordinaire moyen de diffuser des images, des motifs décoratifs et des modes de l'époque et Yoshiwara devint une source d'inspiration inépuisable pour les auteurs de kabuki, les écrivains et les maîtres de l'estampe.

Des courtisanes revêtues de luxueux kosode divertissent un client (broderies, teinture shibori, idéogrammes…).


Sous les Tokugawa (1590-1867), les incendies étaient nombreux à Edo: on en dénombra 86, qualifiés de grands incendies. En cause, les rues étroites d'Edo, les maisons en bois et les vents qui balayaient fréquemment la région. L'incendie de Meireki 3 (1657) est resté tristement célèbre et dura 3 jours et 3 nuits, brûlant la plus grande partie de la ville et faisant plus de 100 000 victimes. Après cet incendie, le bakufu réforma le découpage des quartiers. De nombreuses dispositions furent mises en oeuvre (encouragement pour favoriser les constructions en dur avec des toits en tuiles et des murs épais, élargissements des rues…) mais malgré ces efforts, la violence des incendies ne faiblit pas avec notamment ceux de 1772 et de 1806 qui furent particulièrement destructeurs.
Des corps de pompiers (hikeshi), qui étaient souvent en même temps charpentiers de grande hauteur (tobi), s'organisèrent en systèmes qui ressemblaient à ceux de la police (yoriki et dôshin). Ils devinrent très puissants et un de leur rôle étaient aussi de contrôler le bon fonctionnement des quartiers. Ils étaient alors considérés comme les héros des villes et connus pour leur fanfaronnade, leur vantardise et leur esprit de bravoure au sang chaud typique des gens d'Edo (edokko).
Ces hikeshi portent l'étendard de leur brigade et porte une veste épaisse plus ou moins longue. Ces hanten en coton très épais étaient ornés de magnifiques motifs peints à l'intérieur. Avant l'incendie, ils le mouillaient abondamment pour se protéger et une fois l'incendie maîtrisé, ils le retournaient, signifiant leur victoire sur le feu.

Le motif kamawanu formé par une sorte de rébus qui donne le ton (" kamawanai: Qu'importe !") commence à être porté par une certaine catégorie d'hommes de la moitié du 17e siècle. En effet, il connut une grande popularité parmi des hors-la-loi comme les machiyakko (à gauche), sorte de vigiles qui défendaient les marchands et le petit peuple contre la brutalité des rônin (guerriers sans maître ou en rupture de ban) qui cherchaient querelle aux passants en ville. Ces soldats perdus se reconvertirent en joueurs professionnels vers la fin du 17e siècle et les machiyakko s'orientèrent vers le contrôle du marché de la main d'oeuvre ouvrière.
"Crime et misère au Japon", Philippe Pons.
Kamawanu a été remis au goût du jour par l'acteur de kabuki Ishikawa Danjurô au début du 19e siècle et fait toujours partie des motifs japonais les plus connus. On le trouve souvent sur les yukata, les obi ou les tenugui.
À droite: en 1668, une loi interdit le port des haori tissés en laine et des capes (kappa), d'inspiration étrangère. Pour se protéger de la pluie ou de la neige, le personnage à l'avant porte une cape traditionnelle imperméable tissée en paille (mino).
Au centre: en 1670, le haori se porte très long (naga-haori) et la barbe est interdite. Vers 1680, les haori ornés de kamon se voient de plus en plus.
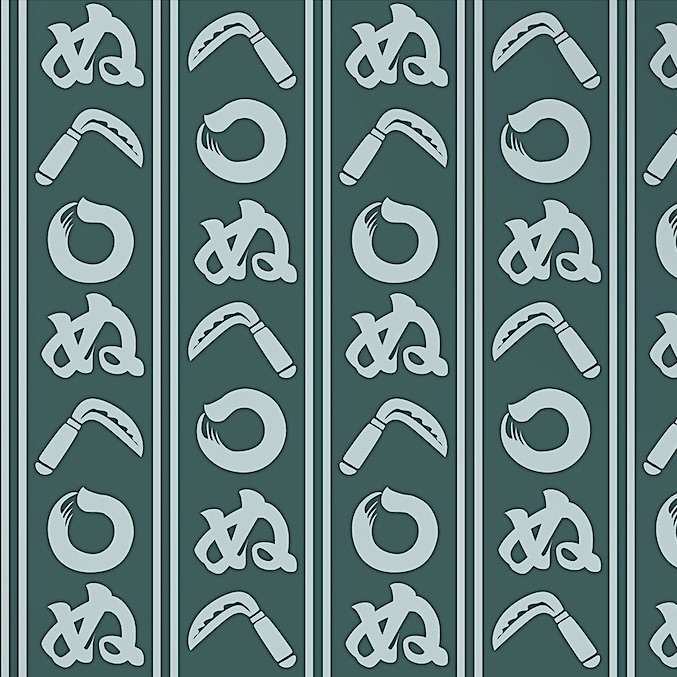
Le motif kamawanu formé par une sorte de rébus donne le ton (" kamawanai: Qu'importe !, "on s'en fiche"") .

Dans les années 1652-55, une nouvelle couleur jinzamomi, vit le jour dans un atelier de teinture sur soie de Kyôto et remplaça avantageusement les onéreuses teintures beni-zome (à base de fleurs de carthame), très appréciées mais souvent interdites par les lois somptuaires. Ce procédé fut très utilisé dans la teinture des doublures de kosode des femmes de la bourgeoisie.

Yuna-zu, "Servantes de bains publics", 17e siècle.
Au début (1615-1644), leur activité consistait seulement à accueillir les client(e)s et à les aider aux bains, mais peu à peu, devenues très populaires et de plus en plus élégantes, les services des yuna (ou kami arai onna, celles qui lavent les cheveux) ne se limitèrent plus seulement au simple lavage. Au-dessus des bains, au premier étage, il y avait des salles de repos où les affaires se négociaient entre clients et servantes et se concrétisaient ensuite dans une chaya (maison de thé) voisine. Plus tard, vers 1652, l'accès aux bains leur sera interdit et elles seront remplacées par des hommes (sansuke).
Il se dégage de cette scène une vitalité et une énergie transmises par les expressions et les attitudes qui contrastent avec les portraits idéalisés des portraits féminins de l'ère kanbun.

Paravent à 6 pans, peint par Kanô Naganobu, Kakayûraku-zu-byôbu (花下遊楽図屏風), 17e siècle.
Derrière un rideau noir, des servantes préparent les boîtes à pique-nique et disposent la vaisselle laquée sur les plateaux repas destinés aux invités qui admirent les cerisiers en fleurs. Les longs kosode sont sobres et maintenus fermés à la taille par de gros cordons (il n'y a pas encore de obi à proprement parlé), les manches sont étroites.

Paravent à 6 pans, peint par Kanô Naganobu, Kakayûraku-zu-byôbu (花下遊楽図屏風), 17e siècle.
Parmi les premières peintures de genre, certaines montrent des activités saisonnières comme des promenades, des pique-niques sous les cerisiers ou évoquent le monde des plaisirs et des premiers théâtres, offrant ainsi un aperçu émouvant des modes et coutumes sociales dans le Japon ancien. Ici, une danse avec éventail exécutée par un groupe de femmes au son d'un tambourin. Elles ont noué leurs luxueux kosode du dessus autour de la taille pour être plus à l'aise. En 1683, une loi somptuaire concernant les vêtements interdit l'utilisation des broderies, des applications de feuilles d'or et de la teinture kanoko shibori.

Paravent à 6 pans, peint par Kanô Naganobu, Kakayûraku-zu-byôbu (花下遊楽図屏風), 17e siècle.
De jeunes hommes vêtus de somptueux kosode, sabre à la main, dansent et imitent probablement une scène de kabuki, un nouveau genre très à la mode à l'époque.

Malgré un régime politique strict et réglementé, le règne des Tokugawa fut une période d'intense bouillonnement culturel et fut caractérisée par sa culture urbaine largement diffusée grâce aux progrès de l'imprimerie et à une alphabétisation progressive des masses populaires. Ce 17e siècle qui se caractérise par une urbanisation rapide avec de fortes migrations fit d'Edo la capitale culturelle du pays où se rencontrèrent la culture populaire paysanne (immigrants), la culture de l'élite guerrière et une nouvelle culture urbaine.